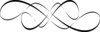Si Lilian Jackson Braun ressemblait à ses quelque trente romans dont les titres commencent tous par : Le chat qui…, ce devait être une dame agréable et charmante, car ses romans sont tous agréables à lire et il s’en dégage un certain charme aimable. Ce sont des romans policiers, on y trouve quelques crimes, et l’un ou l’autre cadavre mais l’enquête est, apparemment, plus que discrète. Ce qui importait à l’auteure, semble-t-il, c’est de donner une parfaite illusion de vie à Pickak, une sympathique bourgade imaginaire, et à des personnages de fiction, et ce, pour notre plus grand plaisir.
Cet automne, le comté de Moose – à 600 kilomètres de partout – est en effervescence : on y prépare une « grande expo gastronomique » qui promet ; bien plus, les gens de Pickak sont très intrigués par la présence d’une femme habillée en noir qui est descendue dans le « Nouvel hôtel », le seul établissement de la ville qui, faute d’entretien, s’est considérablement détérioré ; l’endroit est certes propre et convenable, mais de mémoire d’homme, personne n’y a séjourné plus que deux nuits. Ajoutez à cela un réceptionniste refusant de dire qui elle est ! Le mystère n’en devient que plus piquant.
Pendant ce temps-là, Qwilleran, Quill pour tout le monde, achève d’écrire sa rubrique bihebdomadaire que publie le journal local : Quelque chose du comté de Moose. Quill était journaliste lorsqu’il hérita d’une fortune colossale ; il en confia la majeure partie à un fonds chargé de soutenir des projets intéressants : rénover une maison historique du comté, financer un projet commercial prometteur, agrandir la bibliothèque de Pickak… Lui-même vit dans une grange hexagonale qu’il a fait entièrement moderniser et c’est le personnage principal des trente romans. Enfin, presque, car il faut ajouter ses deux subtils chats siamois : Koko et Yom-Yom, des chats qui savent quand le téléphone va sonner ; qui peuvent dire quand Quill va partir et quand il revient ; qui ne se nourrissent que de mets de choix, après que Quill leur a lu le contenu de la boite ; qui adorent qu’on leur fasse la lecture, avec une prédilection pour Aristophane ; et surtout, surtout, dans chaque roman, qui sèment derrière eux des indices, à interpréter, destinés à démasquer le criminel.
Quill, en quête de sujets pour sa chronique, se décide à aller interroger monsieur Limburger, le propriétaire de l’hôtel, un vieil homme peu amène et avare, avec l’espoir qu’il en sache plus sur la mystérieuse dame en noir. Non seulement l’homme est désagréable, mais quittant Quill pour chasser, dehors, un chien, il trébuche et tombe. Un jeune homme, Scotten, qui vient régulièrement aider Limburger, appelle l’ambulance. Quill et lui font connaissance : il s’occupe de ruches et vient d’être engagé comme mécanicien dans un élevage de dindes. Le propriétaire, un ami de Quill, vante les qualités du jeune homme. Deux sujets à exploiter pour de futures chroniques ?
Et voilà, tout est prêt pour l’intrigue policière ; ne manque plus que l’élément déclencheur. Une bombe explose dans la chambre 102 de l’hôtel, tuant un membre du personnel. C’est la chambre qu’occupait la dame en noir. Celle-ci, illico, prend un taxi pour l’aéroport, monte dans un avion et disparaît, sans laisser d’adresse. Le commissaire ne tarde pas à apprendre (et à révéler à Quill) qu’un homme s’est présenté à la réception avec, à la main, un bouquet de fleurs qu’il venait d’acheter et un paquet, un cadeau disait-il, qu’il tenait, absolument – il insistait – à déposer dans la chambre de cette dame.
Bien qu’il garde à l’esprit l’enquête policière, Quill mène une vie sociale importante : coups de téléphone, visites de courtoisie où l’on retrouve des personnages – sympathiques – des romans précédent. Il cherche, aussi, à savoir qui a dérobé le précieux livre de recettes d’Iris Cobb (une amie de Quill, décédée dans un roman précédent, elle flirtait un peu avec lui, fine cuisinière elle avait noté ses recettes dans un cahier que l’on souhaiterait publier) et surtout, comment le récupérer. Et puis, l’exposition a occasionné l’ouverture de magasins dont l’un présente une belle offre de fromage. Le préféré de Quill est le gruyère, des chats aussi qui ne ratent pas l’occasion pour tenter, en douce, de chiper quelques morceaux. Qui plus est, c’est dans sa grange, où Koko et Yom-Yom vont s’illustrer, qu’a lieu une mémorable dégustation de pas moins de 24 variétés de fromage.
Quill est, aussi, membre du jury appelé à déguster des pâtés, objets d’un concours. Le choix du meilleur prête à des discussions animées et amicales. Enfin l’on met aux enchères des billets, chacun donne droit à un dîner en tête à tête avec la personnalité correspondante. Il obtient la mise la plus élevée.
Pendant ce temps-là, les chats mènent une activité fébrile en relation, bien évidemment, avec l’explosion criminelle ; leur passion pour le gruyère constitue, bien évidemment, un indice à ne pas négliger.
Enfin, alors que retentissent les explosions du feu d’artifice qui clôture les festivités, Koko se met « à hurler à mort », signe qu’un drame vient de se produire. C’est un crime qui vient d’être commis : le fleuriste, resté dans sa boutique (un témoin gênant pour l’assassin), vient d’être tuer à coups de pistolet. Une autre victime s’ajoute, bientôt, à la liste : Scotten découvre que le pêcheur à qui il a loué son cabanon est décédé, empoisonné par une multitude de piqûres d’abeille. Mais est-ce bien une mort aussi naturelle que cela ? Lorsqu’il vide une dinde enfin dégelée (un cadeau anonyme placé sur le pas de sa porte) et qu’il y trouve tout autre chose que les abattis habituels, Quill comprend, à l’instant même, pourquoi ses chats montaient la garde devant la porte du frigo et pourquoi ils raffolaient de gruyère. Il sait, à présent, qui est le meurtrier.
Avec Le chat qui disait cheese, l’auteure nous propose une tranche de vie d’une petite bourgade. Le personnage de Quill semble être l’élément essentiel du récit : il écrit ses chroniques, recherche de nouveaux sujets d’intérêt, rencontre des personnes éminemment sympathiques qui sont pour la plupart des personnages que le lecteur retrouve avec plaisir d’un roman à l’autre, observe ses chats et leurs mimiques…. On entre dans le récit comme dans un lieu familier où une main habile a apporté quelques changements qui excitent la curiosité et où « l’intrigue policière » semble être remisée au fonds d’un placard que l’on ouvre de temps en temps pour y jeter un coup d’œil. Mais, en est-il bien ainsi ? Le récit est fait d’épisodes qui, comme des pièces d’un puzzle, finissent par se rassembler ; l’on découvre, alors, que l’auteure, ménageant ses effets, a semé, tout au long de l’oeuvre, de discrets indices qui mis ensemble, aboutissent à désigner un coupable et à expliquer les raisons des meurtres. Tous les romans de la série Le chat qui… sont bâtis sur une narration savamment construite qui a le bon goût de s’effacer derrière un récit éminemment agréable à lire. Celui-ci ne fait pas exception et sa lecture devrait vous encourager à vous procurer d’autres ouvrages de cette série.